LES SPONGIAIRES (LES ÉPONGES)
C'est l'un des organismes pluricellulaires les plus simples.
Aquatiques, filtreurs, sessiles (fixés au substrat), ce sont des organismes pluricellulaires parmi les plus simples sans véritables tissus mais avec des cellules spécialisées : les choanocytes .
Dans sa forme la plus simple (A), c'est un gobelet formé de deux couches de cellules :
• l'une extérieure joue le rôle de revêtement (ectoderme, 4),
• l'autre intérieure (choanoderme, 6) limite la cavité centrale (2). : elle est constituée de cellules à collerette munies d'un flagelle : les choanocytes.
• Elles sont séparées par une masse gélatineuse, la mésoglée ou mésohyle (7) dans laquelle se trouvent diverses cellules (8) comme les scléroblastes qui fabriquent les spicules (9).
• Les spicules sont des éléments squelettiques calcaires ou siliceux dont la forme et la taille diffèrent d'une espèce à l'autre. Elles peuvent constituer un réseau souple de soutien. Les spicules peuvent être associés à des fibres de spongine. Chez certaines éponges, en l'absence de spicules, seule la spongine assurera le soutien des tissus : c'est notamment le cas chez les éponges naturelles de nos salles de bains.
Le mésohyle renferme également les éléments nerveux diffus, il n'y a pas de système nerveux (pas de réaction quand on les touche).
Les pores sont constituées par une cellule : le porocyte (10).
 |
 |
Schéma de la forme la plus simple |
Détail de la paroi |
|
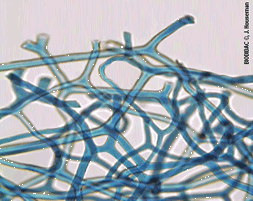 |
Réseau de spicules formant le squelette interne d'une éponge siliceuse |
Réseau de spongine |
 |
 |
| Spicules (MO Grossissement X300) |
|
• Comme chez la plupart des animaux filtreurs, l'alimentation et la respiration sont liées. Par les pores inhalants (1 et 5) entre l'eau riche en O2 et porteuse des particules alimentaires, algues et bactéries principalement. Elle ressort par l'orifice exhalant ou oscule (3) éliminant les déchets. Les cellules qui tapissent la cavité centrale ou choanocytes (6) sont des cellules flagellées. Le mouvement incessant des flagelles est à l'origine du flux d'eau à travers toute l'éponge. La digestion est intracellulaire.
• De nombreuses espèces d'éponges possèdent des symbiontes; telles des cyanobactéries dont les produits de la photosynthèse peuventt dans certains cas couvrir 100% des besoins de l'éponge. D'autres partenaires peuvent être présents, comme des crevettes, crabes, vers et poissons.
• Les éponges du type décrit (A et C) sont rares (clathrine), la cavité forme des replis plus ou moins complexes D et E.
 |
|
Eponge blanche (Leucosolenia sp.) simple, type Ascon(C). |
- Dans le type Sycon, les choanocytes sont rassemblés dans de petits tubes alimentés par un réseau d'eau (D).
- Dans la forme Leucon, les choanocytes sont rassemblés en chambres vibratiles. Un réseau complexe alimente ces chambres.C'est à ce dernier type qu'appartiennent les éponges siliceuses qui sont par ailleurs les plus courantes.
|
C =type ascon D =type sycon E = type leucon |
 |
Différents types de structure chez les éponges |
||
• La reproduction est surtout asexuée, par bourgeonnement. Elles peuvent former des structures d'attente, les gemmules, si les conditions sont défavorables. A noter que les éponges possèdent un fort pouvoir de régénération.
La reproduction peut être sexuée avec fabrication de gamètes, les spermatozoïdes pénètrent à l'intérieur de l'éponge pour assurer la fécondation des ovocytes. La larve sera libérée ensuite dans le milieu où elle nagera librement avant de tomber sur le fond. Là, elle se fixe sur un substrat.
• Les éponges sont en concurrence avec les coraux pour l'espace. Favorisées par des apports en matière organiques, elles ont tendance à coloniser les espaces laisser libres, les coraux morts ou affaiblis. Elles produisent des composés de défense dont notamment des inhibiteurs de la croissance des coraux. Certaines espèces sont perforantes et capables de dissoudre le calcaire grâce à des sécrétions acides. Elles représentent un facteur important d'érosion des récifs (Clione). Elles sont alors capables de détruire partiellement les coraux par perforation.
• On dénombre entre 5 000 espèces d'éponges de part le monde, on les trouve dans tous les milieux aquatiques à toutes les profondeurs. Les éponges sont constitués de 3 groupes :
Les Desmosponges ne présentent que des structures de type Leucon avec des spicules de silice ou de spongine. Les spicules sont différenciés en petits et grands spicules. Hermaphrodites, elles possèdent des molécules soient toxiques ou agissant comme des facteurs de croissance qui ces dernières années ont attiré l'attention des chercheurs. Les desmosponges représentent la plus grande majorité des éponges et sont présentes dans tous les milieux, de la zone de balancement des marées jusqu'aux abysses (8 600m). Elles représentent la quasi totalité des éponges vivant dans les zones coralliennes.
Parmi les desmosponges, on trouve les éponges utilisées pour la toilette (Spongia officinalis). Néanmoins, leur identificaiton est extrêmement difficile de par leurs nombreuses variations morphologiques.
Les Eponges calcaires nécessitent un substrat dur pour se fixer et vivent à des profondeur inférieur à 100M. Leurs spicules forment un squelette calcaire. Elles sont généralement de petites tailles n'excédant pas une dizaine de cm.
Les Eponges Hexatinellides ou éponges de verre : leurs spicules sont formés de 6 pointes qui constituent une construction complexe et élégante. Ces éponges sont abondantes dans les eaux profondes (jusqu'à 200m et plus) et dans les eaux froides et polaires. Les choanocytes ne sont plus individualisés, les cellules ont fusionné et forment un syncytium.
 |
 |
Spheciospongia vagabundus est commune sur le sable du lagon de St Gilles-La Saline. Elle perfore les coquilles et les coraux morts et participent à l'érosion du récif (taille = 30 aine de cm) |
Eponge se développant sur la pente externe; plaque de plusieurs dcm et tubes de 5-6 cm. |
 |
|

