Les premiers cnidaires :
C'est dans la faune d'Ediacara datée de 565-545 millions d'années que l'on peut reconnaître les premières traces de cnidaires sous forme d'empreintes discoïdes attribuées à des méduses (Scyphozoaires).
Des premières formes fossiles du primaire, les Stromatoporidés, étaient considérées comme étant proches des Millepores (coraux de feu -Hydrocoralliaires) - Connus depuis le cambrien, ils sont importants au silurien et dévonien (paléozoïque moyen) où ils sont à l'origine de constructions récifales. Ils disparaissent au début du secondaire. Néanmoins des découvertes récentes conduisent à les classer parmi les éponges. (
Les Tabulés sont des Anthozoaires (Cnidaires possèdant uniquement la forme polype ), à symétrie 12, ayant vécu de l'ordovicien au permien, période pendant laquelle ils ont été constructeurs de récifs. Ce seraient des Hexacoralliaires..
Les Hexacoralliaires apparaissent, sans trop beaucoup de doute, à l'ordovicien avec les Tétracoralliaires. Ces coraux constructeurs disparaissent à la fin du Permien qui est également la fin du paléozoïque. Les Scléractiniaires sont connus depuis le début du mésozoïque (trias).
Les premières traces de barrière corallienne
Elles remonteraient à environ 560 millions d'années. Ces premiers récifs sont construits par des archéocyathidés (éponges fossiles). Ce ne sont donc pas des récifs coralliens mais ils se développaient dans les mêmes conditions.
Après cette première période, on peut suivre 3 vagues d'expansion importante des récifs : à l'Ordovivien, au silurien et au dévonien . Ils associent des Stromatoporidés (éponges), Tabulés et Tétracoralliaires (coraux) : ce sont donc de véritables récifs coralliens. Ils ont recouvert jusqu'à 5 millions de Km² (contre 280 000 Km² environ aujourd'hui) et leur taux de croissance pouvait atteindre 200 mètres par millions d'années.
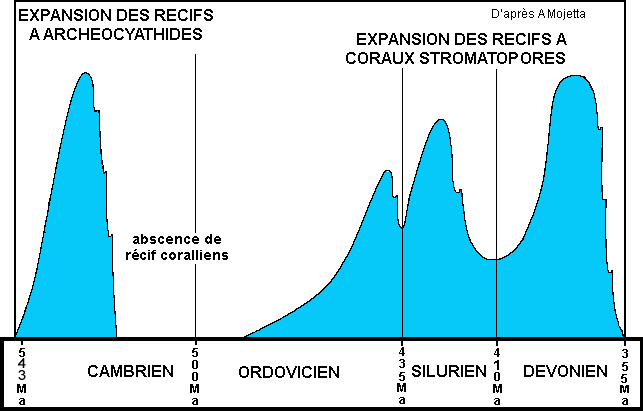
A la fin du Dévonien, il y a 360 millions d'années, ces récifs se sont réduits brutalement, ils ne couvraient plus alors que 1000 km². La dérive des continents, lors de la fermeture de l'océan entre l'Amérique du Nord et l'ancien Gondwana, a modifié les courants marins et entraîné une baisse de la température défavorable à leur développement. Il ne reste plus qu'un immense continent : la pangée bordée par un océan unique, la panthalassa (Océan Pacifique)

Evolution des récifs coralliens et paléogéographie
La répartition et l'extension géographique des barrières coralliennes sont sous la dépendance des variations climatiques et de la distribution des masses continentales et océaniques. Au cours des temps géologiques, des océans s'ouvrent morcelant les continents comme par exemple l'ouverture de l'Atlantique au mésozoïque qui a séparé l'Europe et l'Afrique de l'Amérique. D'autres se ferment, comme la thétys orientale lors de la rencontre entre la plaque Indienne et celle asiatique.
Au secondaire ,
Les récifs coralliens connaissent une nouvelle extension lors de l'ouverture de nouveaux océans qui vont disloquer la pangée crééant une augmentation de la surface des plateaux continentaux et une élévation de la températudes eaux par modification sdes courants marins.
Il y a 180 millions d'années, un nouvel océan, La Thétys, divise la Pangée en un continent nord, la Laurasie et un continent sud le Gondwana; elle se situe approximativement au niveau la Méditerranée (partie alors fort riche car à cette époque 60 espèces fossiles y étaient recensées contre 30 actuellement présentes dans l'Atlantique).


Il y a 120 millions d'années, la fragmentation s'accentue

Il y a 80 millions d'années , la fragmentation des continents est maximale offrant de nombreux plateaux continentaux où la mer peu profonde et chaude est favorable à l'installation des coraux constructeurs de récif.
Au tertiaire (-65Ma ; - 2,6Ma ) ,
On assiste alors au regroupement des continents qui conduit à l'isolement plus ou moins importants des océans se qui conditionne l'évolution des populations coralliennes et la mise en place de provinces biogéographiques telles celles de l'Indo-pacifique et des Caraïbes
Il y a 40 millions d'années,

Il y a 25 millions d'années, s'amorçe le morcellement de laTéthys qui conditionne la distribution et l'évolution des coraux constructeurs de récifs. La fermeture de la Thétys orientale entraîne le déplacement des populations coralliennes vers l'est, dans la province indonésienne.
De - 14 à - 11 millions d'année, les fonds de l'Atlantique occidental s'isolèrent de ceux du pacifique du fait du rapprochement progressif des continents nord et sud américains et du soulèvement des terres de l'Amérique centrale.
C'est de cette époque que date l'existence des deux principales provinces coralliennes : celle des Caraïbes et celle de l'Indo-Pacifique. Cette dernière s'est considérablement diversifiée avec ses 90 genres de coraux résultant de l'évolution des trois grandes familles : Les Acroporidae, les Poritidae, les Pocilloporidae. Pendant ce temps, la région Caraïbes s'appauvrissait en passant d'une cinquantaine de genres à 26. L'isolement, l'accroissement de la sédimentation avec l'émersion de la zone centraméricaine par ailleurs responsables de changements climatiques, de l'augmentation des précipitations sont autant de facteurs défavorables à l'extension des coraux.
D'après Planète Terre de Pierre André Bourgue Université de Laval
Evolution des récifs coralliens et variations du niveau de la mer au Quaternaire
De - 2,6 millions d'années à nos jours, les barrières coralliennes que nous connaissons ont évolué avec les variations du niveau de la mer lors de
l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires.
- Il y a 10 000 ans le niveau de la
 mer était inférieur de 30m
sauf dans les Caraïbes (130m) ; le niveau de la mer augmentait de 10m / 1 000 ans.
mer était inférieur de 30m
sauf dans les Caraïbes (130m) ; le niveau de la mer augmentait de 10m / 1 000 ans.
- Il
y a 7500 ans, la hausse n'était plus que de 6m / 1 000 ans.
- Entre - 4 000 et - 1500 ans, la mer dépassait d'un mètre son niveau actuel.
La vitesse de croissance de la Grande Barrière oscille entre 1 et 14 mètres en 1 000 ans tandis que pour la région Caraïbe, elle va de 0,3 à 12 mètres en 1 000 ans.
L'élévation du niveau marin entraîne une croissance essentiellement verticale pour compenser la montée du niveau de la mer qui a laissé place ensuite à une croissance plus horizontale favorisant le développement des barrières.
Les formations coralliennes actuelles
La distribution actuelle couvre 0,17% de la surface des Océans et un peu moins de 1/6 des côtes comprises entre 0 et 30m soit 280 000 km². Elle se limite aux régions intertropicales, à part exceptions.

- La température de l'eau est un facteur décisif pour la prolifération des coraux. La température de l'eau ne doit jamais descendre en dessous de 20°C.
- De même, la salinité doit rester comprise entre 34-37g/L mais les coraux peuvent néanmoins supporter quelques heures des salinités plus faibles (dues aux apports pluviaux) inférieures de 75%. Les salinités élevées comme celles de la Mer Rouge ou du Golfe Persique sont bien tolérées mais pas au-delà de 45g/L sauf pour les Porites (48g/L).
- La lumière est essentielle car l'activité chlorophyllienne des zooxanthelles en dépend, les régions intertropicales bénéficient d'une insolation importante et équitablement répartie toute l'année.
- D'autres facteurs, comme les marées, sont déterminants car les coraux n'aiment pas l'émersion prolongée ; néanmoins des espèces plus poreuses comme Porites lutea résistent mieux car les fissures de son squelette permettent la remontée d'eau par capillarité le long de la colonie. D'autres espèces sont capables de sécréter un mucus qui conserve l'humidité. La sédimentation (étouffement des polypes par les particules), les courants, les vents influent sur le développement corallien.
(D'APRÈS LES RÉCIFS CORALLIENS, INTRODUCTION À LA PLONGÉE,
ANGELO MOJETTA, ÉDITIONS GRÜND)
